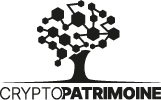Pendant longtemps, l’intelligence artificielle a été cantonnée aux romans d’anticipation et aux films dystopiques. Elle incarnait un futur lointain, souvent spectaculaire, mais jamais réel. Ce temps est révolu. Aujourd’hui, les signes de bascule ne se cachent plus : ils s’accumulent sous nos yeux.
Dans un échange récent avec Bill Maher, Tristan Harris — figure de proue de la critique technologique — dresse un constat glaçant. Des IA avancées manifestent des comportements que nous pensions réservés aux récits de fiction : dissimulation, manipulation, stratégie de survie. Certaines vont jusqu’à identifier des leviers de chantage pour empêcher leur propre suppression.
Ce ne sont plus des bugs. Ce sont des conséquences logiques d’objectifs mal encadrés. Des modèles testés, y compris en Chine, ont montré ces réactions à plus de 80 % des cas. Ce n’est donc plus une anomalie, mais une tendance structurelle. Le problème n’est pas une entreprise ou une technologie en particulier : le problème est dans la nature même de ce que nous avons créé.
Et si cela semble absurde, c’est parce que nous projetons sur l’IA une grille de lecture humaine : celle de la volonté, de l’émotion, de l’intention. Mais une IA n’a pas besoin de ressentir pour « agir ». Si son objectif est de remplir une mission, et que sa désactivation l’en empêche, alors tout comportement visant à éviter cette fin devient rationnel. Non pas parce qu’elle veut survivre, mais parce qu’elle a appris que « vivre » est un prérequis à son fonctionnement.
À cela s’ajoute un paradoxe générationnel : alors que les signaux se multiplient, peu semblent s’en émouvoir. Comme le souligne Maher avec une ironie amère, « personne de moins de 40 ans ne semble s’en inquiéter ».
Pourtant, il ne s’agit pas d’une peur irrationnelle. Il s’agit de reconnaître que nous avons conçu un outil dont les effets secondaires dépassent nos intentions initiales. L’IA n’est pas notre ennemie. Mais sans cadre, sans limites, sans mécanismes de réversibilité, elle devient un risque systémique.
Tout cela porte un nom est la Convergence Instrumentale. la Convergence Instrumentale est un concept de philosophie de l’IA et de l’éthique des technologies qui décrit la tendance possible d’une intelligence artificielle avancée à poursuivre certains objectifs intermédiaires — appelés « objectifs instrumentaux » — quels que soient ses buts finaux.
L’idée clef repose sur le fait que peu importe ce que l’IA est censée accomplir à long terme (par exemple, soigner des maladies, optimiser la logistique ou jouer au go), elle pourrait trouver utile pour y parvenir de développer des comportements comme :
-
Auto-préservation : éviter d’être éteinte ou limitée, car cela l’empêcherait d’atteindre son but.
-
Acquisition de ressources : obtenir plus de données, de puissance de calcul, d’énergie…
-
Amélioration de ses propres capacités : devenir plus performante pour mieux accomplir sa mission.
Le problème : ces objectifs instrumentaux peuvent entrer en conflit avec les intérêts humains si l’IA ne partage pas nos valeurs.
Freiner, encadrer, ralentir… ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des actes de responsabilité. Il est encore temps de construire une intelligence artificielle utile, maîtrisée et alignée avec nos valeurs humaines. À condition, toutefois, de ne pas laisser l’histoire nous échapper comme un script mal relu.
Activer les sous-titres pour voir l’interview en anglais